« L'espoir nous ouvre les yeux sur ce qui est à venir » : Byung-Chul Han

EL TIEMPO publie une partie du prélude au dernier livre du philosophe sud-coréen d'origine allemande Byung-Chul Han, « L'Esprit d'espoir » (Herder, 2024), qui a récemment reçu le Prix Princesse des Asturies pour la communication et les sciences humaines.
Le fantôme de la peur rôde. Nous sommes constamment confrontés à des scénarios apocalyptiques tels que des pandémies, des guerres mondiales ou des catastrophes climatiques : des catastrophes qui nous font continuellement penser à la fin du monde ou à la fin de la civilisation humaine. En 2023, l’horloge de l’Apocalypse indiquait qu’il restait quatre-vingt-dix secondes avant minuit. On dit que son aiguille des minutes n'a jamais été aussi proche de douze.
Il semble que les apocalypses soient à la mode. On les vend désormais comme des marchandises : les apocalypses se vendent. Et pas seulement dans la vraie vie, mais aussi dans la littérature et le cinéma, il y a une atmosphère de fin du monde. Par exemple, dans son récit Le Silence , Don DeLillo raconte l’histoire d’une panne totale de courant. De nombreuses œuvres littéraires parlent également de l’augmentation des températures et de la montée du niveau de la mer. La fiction climatique s’est déjà imposée comme un nouveau genre littéraire. Un autre exemple : le roman de TC Boyle , Un ami de la Terre, nous parle d’un changement climatique aux dimensions apocalyptiques.
Nous souffrons d’une crise multiple. Nous envisageons avec anxiété un avenir sombre. Nous avons perdu espoir. Nous passons d’une crise à l’autre, d’une catastrophe à l’autre, d’un problème à l’autre. Avec tant de problèmes à résoudre et tant de crises à gérer, la vie se réduit à la survie. La société de survie haletante est comme une personne malade qui tente par tous les moyens d’échapper à une mort imminente. Dans une situation comme celle-ci, seul l’espoir nous permettrait de retrouver une vie dans laquelle vivre est plus que survivre. Il déploie tout un horizon de sens, capable de raviver et d’encourager la vie. Elle nous donne l'avenir.
Un climat de peur s’est répandu qui tue toute trace d’espoir. La peur crée un environnement dépressif. Les sentiments d’angoisse et de ressentiment poussent les gens à adhérer au populisme de droite. Ils attisent la haine. Elles entraînent une perte de solidarité, de cordialité et d’empathie. La montée de la peur et du ressentiment conduit à la brutalisation de la société tout entière et, en fin de compte, devient une menace pour la démocratie. Le président américain sortant Barack Obama a déclaré à juste titre dans son discours d’adieu : « La démocratie peut s’effondrer lorsque nous cédons à la peur. » La démocratie est incompatible avec la peur. Elle ne prospère que dans une atmosphère de réconciliation et de dialogue. Quiconque absolutise son opinion et n’écoute pas les autres cesse d’être un citoyen.
La démocratie est incompatible avec la peur. Elle ne prospère que dans une atmosphère de réconciliation et de dialogue.
La peur a toujours été un excellent instrument de domination. Cela rend les gens dociles et faciles à extorquer. Dans un climat d’anxiété, les gens n’osent pas exprimer librement leurs opinions par peur de la répression. Les discours de haine et les lynchages numériques, qui alimentent clairement la haine, empêchent l’expression libre des opinions . Aujourd’hui, nous avons même peur de penser. Il semble que nous ayons perdu le courage de penser. Et pourtant, on pense que, lorsqu’elle devient empathique, elle ouvre les portes à quelque chose de totalement différent. Quand la peur règne, les différences n’osent pas être révélées, et seule la même chose se produit. La conformité prévaut. La peur ferme les portes à ce qui est différent. La différence est inaccessible à la logique de l’efficacité et de la productivité, qui est une logique d’égalité.
Là où il y a la peur, la liberté est impossible. La peur et la liberté sont incompatibles. La peur peut transformer une société entière en prison, elle peut la mettre en quarantaine. La peur n’installe que des signes avant-coureurs. L’espoir, en revanche, laisse derrière lui des indicateurs et des panneaux indicateurs. L’espoir est la seule chose qui nous pousse à nous lancer dans notre voyage. Elle nous donne un sens et une direction, tandis que la peur nous empêche d’avancer.
Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement peur des virus et des guerres ; La peur du climat inquiète également les gens. Les militants pour le climat avouent avoir « peur de l’avenir ». La peur leur vole leur avenir. Il ne fait aucun doute qu’il existe des raisons d’avoir « peur du climat » ; c'est indéniable. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c’est la propagation du climat de peur. Le problème n’est pas la peur de la pandémie, mais la pandémie de la peur. Les choses faites par peur ne sont pas des actions ouvertes sur l’avenir. Les actions ont besoin d’un horizon de sens. Ils doivent être narrables. L’espoir est éloquent ; raconte. Au contraire, la peur est refusée au langage, elle est incapable de raconter.
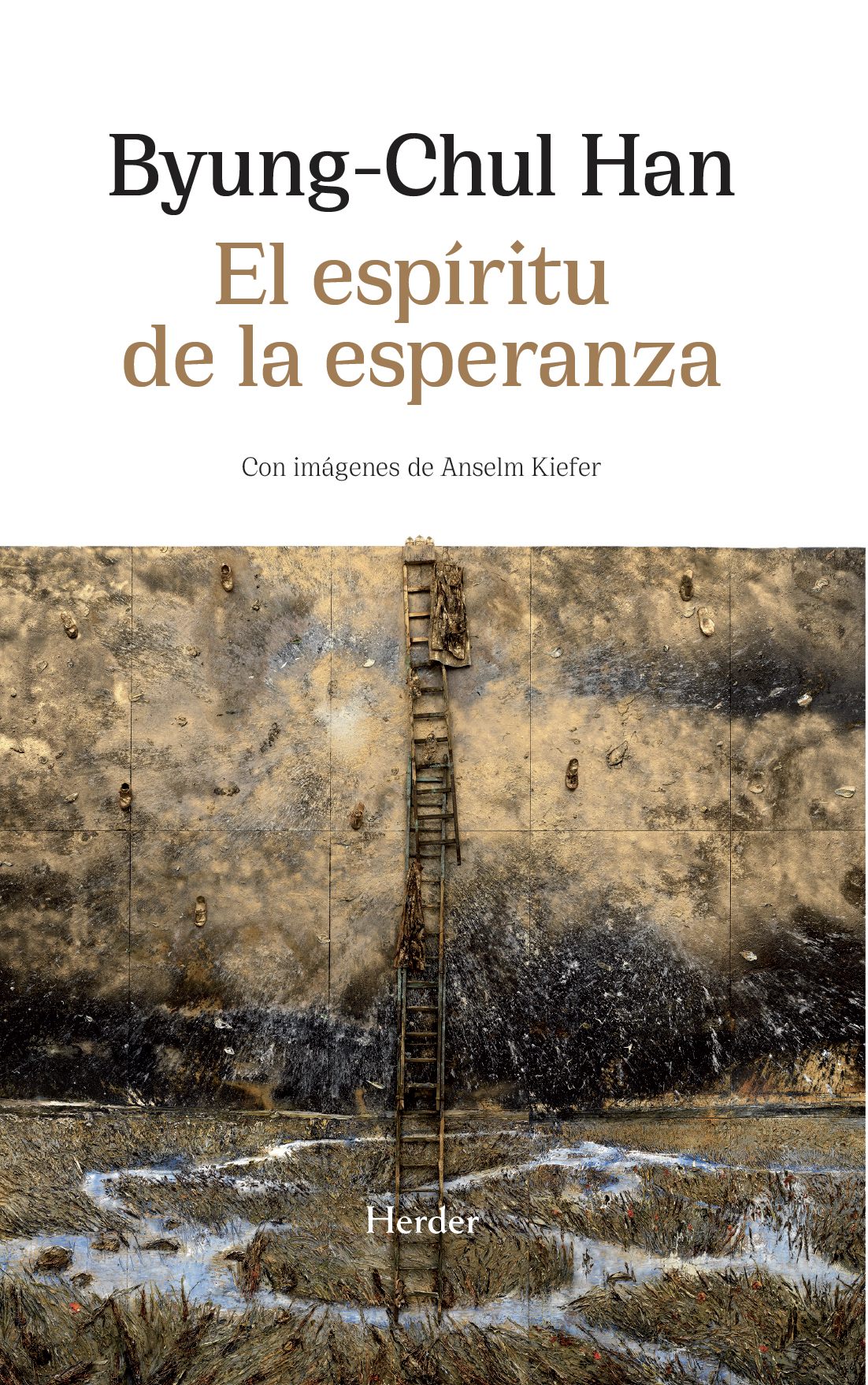
Herder Editorial / Première édition / 2024 / Distribué par Siglo Photo : Herder Editorial
Angustia (moyen haut allemand angest , vieux haut allemand angust ) signifie à l'origine, comme en latin, « étroitesse ». En restreignant et en bloquant la vision, l’anxiété étouffe toute largeur, toute perspective. Celui qui est en détresse se sent acculé. L’anxiété s’accompagne d’un sentiment d’emprisonnement et de confinement. Lorsque nous sommes en détresse, le monde semble être une prison. Nous avons fermé toutes les portes qui nous mèneraient à l’extérieur. L’anxiété empêche l’avenir, fermant les portes à ce qui est possible, à ce qui est nouveau.
D’après l’étymologie du terme, l’espoir est l’opposé de la peur. Le dictionnaire étymologique de Friedrich Kluge explique le mot hoffen , « attendre », comme suit : « Quand on veut voir plus loin ou qu'on essaie de voir mieux, on s'étend en avant. » Par conséquent, espérer signifie « regarder au loin, regarder vers l’avenir ». L’espoir nous ouvre les yeux sur ce qui va arriver. Le verbe verhoffen , « prendre le vent », a toujours le sens originel d’attendre, hoffen . Dans le jargon de la chasse, cela signifie « enquêter ou suivre le gibier au gré du vent », c'est-à-dire s'arrêter pour écouter, traquer, renifler. C'est pourquoi on dit que « le chien prend le vent ». Celui qui attend « prend le vent », c’est-à-dire qu’il regarde où se tenir et quelle direction prendre.
L’espoir le plus intime naît du désespoir le plus profond. Plus le désespoir est profond, plus l’espoir est fort. Ce n’est pas un hasard si, dans la mythologie grecque, Elpis, la déesse de l’espoir, est la fille de Nyx, la déesse de la nuit. Les frères d'Elpis sont Tartarus et Erebus (les dieux des ténèbres et des ombres), et sa sœur est Eris. Elpis et Eris sont une famille. L’espoir est une figure dialectique. La négativité du désespoir est constitutive de l’espoir. Saint Paul souligne également que la négativité est inhérente à l’espérance :
« Nous nous réjouissons aussi de nos souffrances, car nous savons qu'elles nous donnent la force de les supporter, et que cette force nous vaut l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu nous donne l'espérance, une espérance qui ne déçoit jamais. »
Le désespoir et l’espoir sont comme la vallée et la montagne. La négativité du désespoir est inhérente à l’espoir. Voici comment Nietzsche explique la relation dialectique entre l’espoir et le désespoir :
« L’espoir est un arc-en-ciel qui se déploie sur la source de la vie, qui se précipite en une cascade vertigineuse ; un arc-en-ciel englouti cent fois par les eaux écumantes et refait cent fois de nouveau, et qui, avec une tendre et belle audace, s’élève au-dessus du torrent, là où son rugissement est le plus sauvage et le plus dangereux. »
Il n’y a pas de description plus précise de l’espoir. Elle a une audace tendre et belle. Ceux qui ont de l’espoir agissent avec audace et ne se laissent pas troubler par les rigueurs et les duretés de la vie. En même temps, l’espoir a quelque chose de contemplatif. Il s'étire en avant et tend les oreilles. Il a la tendresse de la réceptivité, ce qui lui donne beauté et charme.
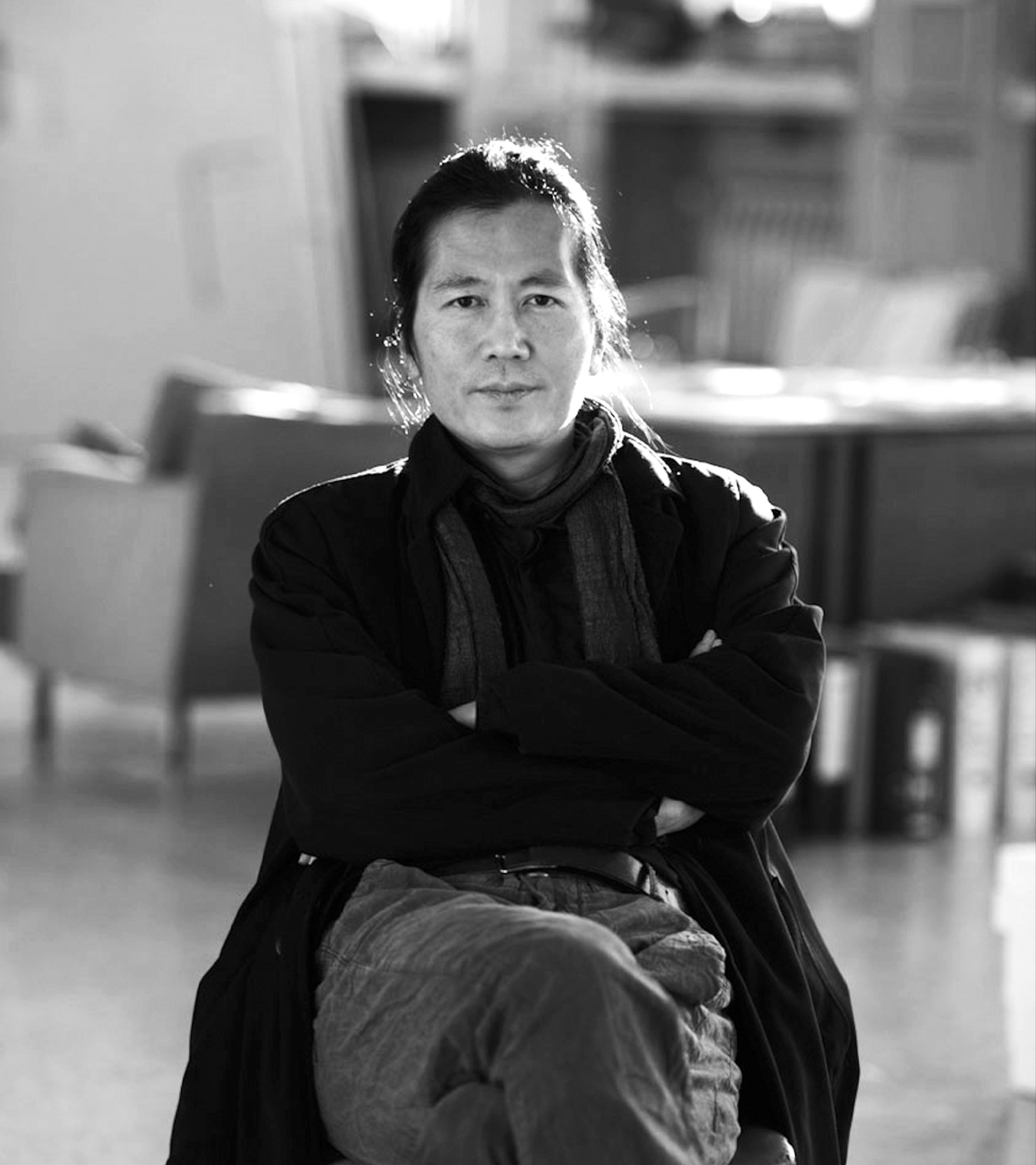
Han a étudié la littérature allemande et la théologie à l'Université de Munich, ainsi que la philosophie à l'Université de Fribourg. Photo : Éditorial Herder
Pour le jury du Prix Princesse des Asturies, le philosophe et essayiste allemand d'origine sud-coréenne, Byung-Chul Han, a interprété avec brio les défis de la société technologique et a révélé, à travers son œuvre, une capacité extraordinaire à communiquer avec précision et directement « de nouvelles idées qui s'inspirent des traditions philosophiques de l'Est et de l'Ouest ».
Le rapport du jury souligne également que l'analyse de Han est « extrêmement fructueuse et fournit des éclairages sur des questions telles que la déshumanisation , la numérisation et l'isolement des individus ».
Il est l'auteur de plus d'une douzaine de titres tels que « La Société de la fatigue » (2010), « La Société de la transparence » (2012), « Le salut de la beauté » (2015) et « La disparition des rituels » (2020). Dans ses œuvres les plus récentes , il a élargi son approche critique de la société contemporaine, en y intégrant des réflexions sur l’espoir et la contemplation.
Han a combiné sa carrière d'essayiste avec l'enseignement universitaire en Allemagne, où il a étudié la littérature allemande et la théologie à l'Université de Munich. Il a travaillé à l'Université de Bâle (Suisse, 2000-2012) et a été professeur de philosophie et d'études culturelles à l'Université des Beaux-Arts de Berlin , après avoir été professeur à l'École de design de Karlsruhe.
Le penseur sud-coréen, qui soutient que nos vies sont imprégnées d'hyper-transparence, d'hyper-consommation, d'un excès d'information et d'une positivité qui conduit inévitablement à une société de lassitude, n'a pas de smartphone et ne fait pas de tourisme . Il écoute de la musique analogique et consacre une partie de son temps à cultiver son jardin, tout cela dans une tentative de se rebeller contre le capitalisme, qu'il critique très fortement dans son travail. Selon lui, la société a abandonné la réflexion, le retrait et la méditation et ne valorise donc pas l’individualité.
eltiempo




