Des physiciens créent un thermomètre pour mesurer la «quanticité»
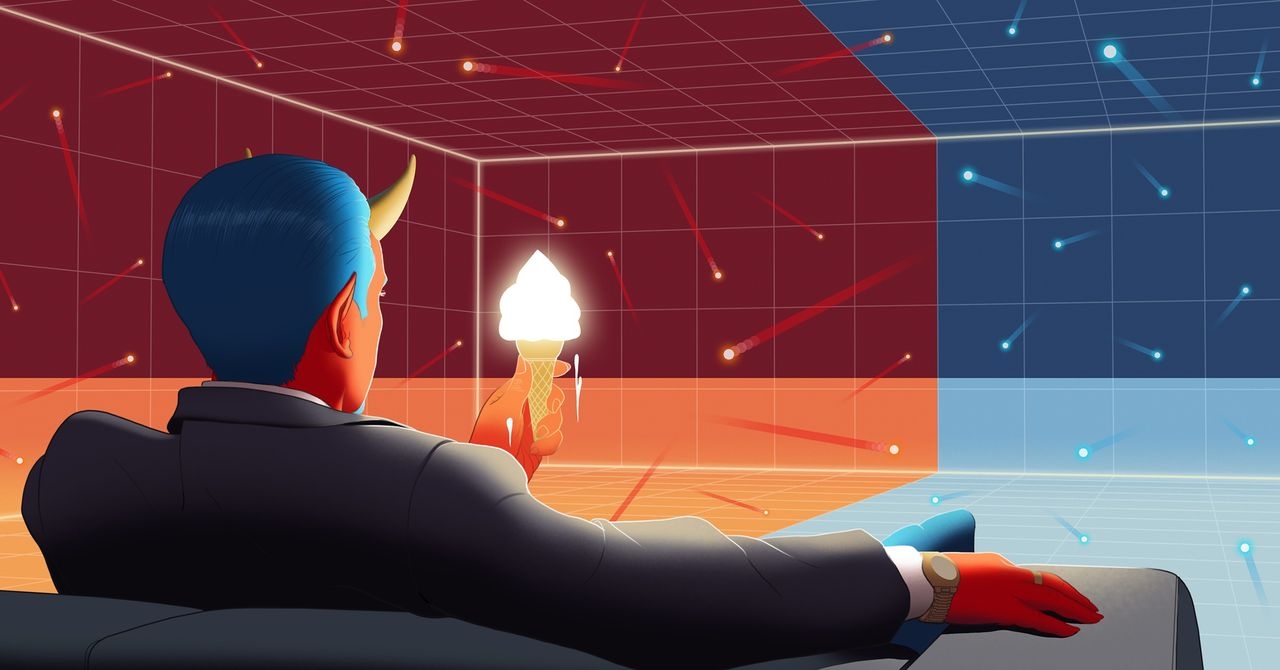
Tous les produits présentés sur WIRED sont sélectionnés indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons toutefois recevoir une compensation de la part des détaillants et/ou pour les achats effectués via ces liens. En savoir plus.
La version originale de cet article est parue dans Quanta Magazine .
S'il est une loi de la physique qui semble facile à comprendre, c'est bien la seconde loi de la thermodynamique : la chaleur se propage spontanément des corps chauds vers les corps froids. Or, voilà qu'Alexandre de Oliveira Jr. vient de me démontrer, avec une douceur presque désinvolte, que je ne l'avais pas vraiment comprise.
« Prenez cette tasse de café brûlante et ce pichet de lait froid », dit le physicien brésilien alors que nous étions assis dans un café de Copenhague. « Mettez-les en contact et, comme prévu, la chaleur se déplacera de l'objet chaud vers l'objet froid, comme l'avait formellement établi le scientifique allemand Rudolf Clausius en 1850. Cependant, dans certains cas, expliqua de Oliveira, les physiciens ont découvert que les lois de la mécanique quantique peuvent engendrer un flux de chaleur dans le sens inverse : du froid vers le chaud. »
Cela ne signifie pas pour autant que le second principe de la thermodynamique est erroné, ajouta-t-il tandis que son café refroidissait paisiblement. Simplement, l'expression de Clausius représente la « limite classique » d'une formulation plus complète exigée par la physique quantique.
Les physiciens ont commencé à saisir la subtilité de cette situation il y a plus de vingt ans et explorent depuis lors la version quantique du second principe de la thermodynamique. Aujourd'hui, de Oliveira, chercheur postdoctoral à l'Université technique du Danemark, et ses collègues ont démontré que ce type de « flux de chaleur anormal », rendu possible à l'échelle quantique, pourrait avoir une application aussi pratique qu'ingénieuse.
Selon eux, cette méthode pourrait permettre de détecter facilement la « nature quantique » — par exemple, qu'un objet se trouve dans une « superposition » quantique de plusieurs états observables possibles, ou que deux objets de ce type sont intriqués, leurs états étant interdépendants — sans altérer ces phénomènes quantiques délicats. Un tel outil de diagnostic pourrait servir à vérifier qu'un ordinateur quantique utilise bien les ressources quantiques pour effectuer ses calculs. Il pourrait même permettre de détecter les aspects quantiques de la force de gravité, un des objectifs ambitieux de la physique moderne. Il suffit, expliquent les chercheurs, de connecter un système quantique à un second système capable de stocker des informations le concernant, et à un dissipateur thermique : un corps capable d'absorber une grande quantité d'énergie. Ce dispositif permet d'amplifier le transfert de chaleur vers le dissipateur, dépassant ainsi les limites de la physique classique. En mesurant simplement la température du dissipateur, on pourrait alors détecter la présence de superposition ou d'intrication dans le système quantique.
Au-delà des avantages pratiques, cette recherche met en lumière un nouvel aspect d'une vérité fondamentale de la thermodynamique : la manière dont la chaleur et l'énergie se transforment et se déplacent dans les systèmes physiques est intimement liée à l'information, c'est-à-dire à ce que l'on sait ou peut savoir de ces systèmes. Dans ce cas précis, le flux de chaleur anormal est « payé » par la perte d'informations stockées sur le système quantique.
« J’adore l’idée que les grandeurs thermodynamiques puissent révéler des phénomènes quantiques », a déclaré la physicienne Nicole Yunger Halpern de l’Université du Maryland. « Le sujet est fondamental et profond. »
Le savoir, c'est le pouvoirLe lien entre le second principe de la thermodynamique et l'information a été exploré pour la première fois au XIXe siècle par le physicien écossais James Clerk Maxwell. À son grand désarroi, le second principe de Clausius semblait impliquer que des poches de chaleur se dissiperaient dans tout l'univers jusqu'à ce que toutes les différences de température disparaissent. Dans ce processus, l'entropie totale de l'univers – en simplifiant, une mesure de son désordre et de son uniformité – augmenterait inexorablement. Maxwell comprit que cette tendance finirait par supprimer toute possibilité d'exploiter les flux de chaleur pour produire un travail utile, et que l'univers s'installerait dans un équilibre stérile, baigné d'un bourdonnement uniforme d'agitation thermique : une « mort thermique ». Cette prévision aurait de quoi inquiéter n'importe qui. Elle était insupportable pour Maxwell, fervent chrétien. Mais dans une lettre à son ami Peter Guthrie Tait en 1867, Maxwell affirma avoir trouvé un moyen de « trouver une faille » dans le second principe.

« Il est impossible pour une machine fonctionnant par elle-même, sans l'aide d'aucun agent extérieur, de transmettre de la chaleur d'un corps à un autre à une température plus élevée », écrivait Rudolf Clausius (en allemand) en 1850. C'était la première expression de la deuxième loi de la thermodynamique.
Photo : Bettmann/Getty ImagesIl imagina un être minuscule (surnommé plus tard démon) capable de percevoir les mouvements des molécules individuelles d'un gaz. Ce gaz emplissait une boîte divisée en deux par une paroi munie d'une trappe. En ouvrant et fermant la trappe à volonté, le démon pouvait isoler les molécules les plus rapides dans un compartiment et les plus lentes dans l'autre, créant ainsi un gaz chaud et un gaz froid. En exploitant les informations recueillies sur les mouvements moléculaires, le démon réduisait l'entropie du gaz, créant un gradient de température exploitable pour produire un travail mécanique, comme actionner un piston.
Les scientifiques étaient persuadés que le démon de Maxwell ne pouvait pas réellement enfreindre le second principe de la thermodynamique, mais il leur a fallu près d'un siècle pour en comprendre la raison. L'explication réside dans le fait que les informations que le démon collecte et stocke sur les mouvements moléculaires finissent par saturer sa mémoire limitée. Celle-ci doit alors être effacée et réinitialisée pour qu'il puisse continuer à fonctionner. En 1961, le physicien Rolf Landauer a démontré que cet effacement consomme de l'énergie et produit de l'entropie – plus d'entropie que celle réduite par les opérations de tri effectuées par le démon. L'analyse de Landauer a établi une équivalence entre information et entropie, impliquant que l'information elle-même peut agir comme une ressource thermodynamique : elle peut être transformée en travail. Des physiciens ont démontré expérimentalement cette conversion d'information en énergie en 2010.

Perturbé par la deuxième loi de la thermodynamique, le physicien écossais James Clerk Maxwell a inventé une expérience de pensée sur un démon omniscient qui continue de fournir des enseignements aujourd'hui encore.
Illustration : The Print Collector/Heritage ImagesMais les phénomènes quantiques permettent de traiter l'information d'une manière que la physique classique n'autorise pas ; c'est le fondement même de technologies telles que l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Et c'est pourquoi la théorie quantique remet en cause le second principe de la thermodynamique.
Exploiter les corrélationsLes objets quantiques intriqués possèdent une information mutuelle : ils sont corrélés, ce qui nous permet de découvrir les propriétés de l'un en observant l'autre. En soi, ce n'est pas si étrange ; si l'on regarde un gant et qu'on constate qu'il est gaucher, on sait que l'autre est droitier. Mais une paire de particules quantiques intriquées diffère des gants d'une manière particulière : alors que la chiralité des gants est déjà déterminée avant même qu'on les observe, ce n'est pas le cas pour les particules, selon la mécanique quantique. Avant toute mesure, la valeur de la propriété observable de chaque particule de la paire intriquée est indéterminée. À ce stade, nous ne pouvons connaître que les probabilités des combinaisons possibles de valeurs, par exemple 50 % gauche-droite et 50 % droite-gauche. Ce n'est que lorsque nous mesurons l'état de l'une des particules que ces possibilités se résolvent en un résultat précis. Lors de cette mesure, l'intrication est détruite.
Si les molécules de gaz sont ainsi intriquées, un démon de Maxwell peut les manipuler plus efficacement que si elles se déplaçaient indépendamment. Par exemple, si le démon sait que toute molécule se déplaçant rapidement est corrélée de telle sorte qu'elle sera suivie un instant plus tard par une autre molécule rapide, il n'a pas besoin d'observer cette seconde particule avant d'ouvrir la trappe pour la laisser entrer. Le coût thermodynamique de la violation (temporaire) du second principe de la thermodynamique est ainsi réduit.
En 2004, les théoriciens quantiques Časlav Brukner (Université de Vienne) et Vlatko Vedral (alors à l'Imperial College de Londres) ont souligné que cela signifie que les mesures thermodynamiques macroscopiques peuvent servir de « témoin » pour révéler la présence d'intrication quantique entre particules. Ils ont démontré que, sous certaines conditions, la capacité thermique d'un système ou sa réponse à un champ magnétique appliqué devrait porter la marque de cette intrication, si elle existe.
Dans le même ordre d'idées, d'autres physiciens ont calculé qu'il est possible d'extraire plus de travail d'un corps chaud lorsqu'il existe un enchevêtrement quantique dans le système que lorsqu'il est purement classique.
En 2008, le physicien Hossein Partovi , de l'Université d'État de Californie, a mis en évidence une implication particulièrement frappante de la manière dont l'intrication quantique peut remettre en question les idées reçues issues de la thermodynamique classique. Il a constaté que la présence d'intrication peut inverser le flux spontané de chaleur d'un corps chaud vers un corps froid, ce qui semble contredire la seconde loi de la thermodynamique.
Ce renversement constitue une forme particulière de réfrigération, explique Yunger Halpern. Et comme toujours en matière de réfrigération, ce procédé a un coût (et ne remet donc pas véritablement en cause le second principe de la thermodynamique). Classiquement, refroidir un objet nécessite une énergie : il faut transférer la chaleur dans le « mauvais » sens en consommant du combustible, compensant ainsi l'entropie perdue lorsque l'objet froid est refroidi davantage et l'objet chaud davantage. Mais dans le cas quantique, poursuit Yunger Halpern, au lieu de brûler du combustible pour obtenir une réfrigération, « on brûle les corrélations ». Autrement dit, à mesure que le flux de chaleur anormal se propage, l'intrication est détruite : les particules qui possédaient initialement des propriétés corrélées deviennent indépendantes. « Nous pouvons utiliser les corrélations comme une ressource pour déplacer la chaleur dans la direction opposée », conclut Yunger Halpern.

Vlatko Vedral est l'un des initiateurs de l'idée d'utiliser des mesures thermodynamiques comme « témoin » pour révéler la présence d'intrication quantique entre les particules.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Vlatko VedralEn réalité, le carburant ici, c'est l'information elle-même : plus précisément, l'information mutuelle des corps chauds et froids enchevêtrés.
Deux ans plus tard, David Jennings et Terry Rudolph, de l'Imperial College de Londres, ont clarifié la situation. Ils ont démontré comment le second principe de la thermodynamique pouvait être reformulé pour inclure le cas où l'information mutuelle est présente, et ils ont calculé les limites de la modification, voire de l'inversion, du flux de chaleur classique par la consommation des corrélations quantiques.
Le démon saitLorsque les effets quantiques entrent en jeu, la seconde loi de la thermodynamique se complexifie. Mais peut-on tirer profit de la manière dont la physique quantique assouplit les contraintes des lois thermodynamiques ? C’est l’un des objectifs de la thermodynamique quantique, discipline dans laquelle certains chercheurs s’efforcent de concevoir des moteurs quantiques plus performants que les moteurs classiques, ou des batteries quantiques à charge plus rapide.
Patryk Lipka-Bartosik, du Centre de physique théorique de l'Académie polonaise des sciences, a exploré des applications pratiques dans l'autre sens : utiliser la thermodynamique comme outil d'étude de la physique quantique. L'année dernière, avec ses collaborateurs, il a démontré comment concrétiser l'idée de Brukner et Vedral (2004) d'utiliser les propriétés thermodynamiques comme témoins de l'intrication quantique. Leur dispositif repose sur des systèmes quantiques chauds et froids corrélés, et un troisième système assurant la médiation du flux de chaleur entre les deux. Ce troisième système peut être assimilé au démon de Maxwell, à ceci près qu'il possède une « mémoire quantique » capable de s'intriquer avec les systèmes qu'il manipule. Cette intrication avec la mémoire du démon permet de lier les systèmes chauds et froids, autorisant ainsi le démon à déduire des propriétés de l'un à partir de celles de l'autre.

Patryk Lipka-Bartosik a exploré comment utiliser les mesures thermodynamiques pour détecter les effets quantiques.
Photographie : Alicja Lipka-BartosikUn tel démon quantique peut agir comme un catalyseur, facilitant le transfert de chaleur grâce à l'accès à des corrélations autrement inaccessibles. En effet, étant intriqué avec les objets chaud et froid, le démon peut percevoir et exploiter systématiquement toutes leurs corrélations. Et, à l'instar d'un catalyseur, ce troisième système retourne à son état initial une fois l'échange de chaleur entre les objets terminé. De cette manière, le processus peut amplifier le flux de chaleur anormal au-delà de ce qui serait possible sans un tel catalyseur.
L'article publié cette année par de Oliveira, co-écrit par Lipka-Bartosik et Jonatan Bohr Brask de l'Université technique du Danemark, reprend certaines de ces idées, mais avec une différence cruciale qui transforme le dispositif en une sorte de thermomètre pour mesurer la nature quantique. Dans les travaux précédents, la mémoire quantique, comparable à un démon, interagissait avec une paire de systèmes quantiques corrélés, l'un chaud et l'autre froid. Dans les travaux les plus récents, elle se situe entre un système quantique (par exemple, un réseau de bits quantiques intriqués, ou qubits, dans un ordinateur quantique) et un simple dissipateur thermique avec lequel le système quantique n'est pas directement intriqué.
Comme la mémoire est intriquée à la fois avec le système quantique et le dissipateur thermique, elle peut à nouveau catalyser un flux de chaleur entre eux, au-delà des limites de la physique classique. Dans ce processus, l'intrication au sein du système quantique se convertit en chaleur supplémentaire qui pénètre dans le dissipateur. Ainsi, mesurer l'énergie stockée dans le dissipateur thermique (équivalent à mesurer sa « température » ) révèle la présence d'intrication dans le système quantique. Mais comme le système et le dissipateur ne sont pas intriqués, la mesure n'affecte pas l'état du système quantique. Cette astuce contourne le problème bien connu de la destruction de la nature quantique par les mesures. « Si vous essayiez simplement de mesurer directement le système [quantique], vous détruiriez son intrication avant même que le processus ne puisse se dérouler », a déclaré de Oliveira.

Les physiciens Alexssandre de Oliveira Jr. (à gauche) et Jonatan Bohr Brask (à droite) ont collaboré avec Patryk Lipka-Bartosik sur un nouveau schéma pour détecter la nature quantique sans la détruire.
Photographie : Jonas Schou Neergaard-NielsenLe nouveau schéma présente l'avantage d'être simple et général, a déclaré Vedral, actuellement à l'Université d'Oxford. « Ces protocoles de vérification sont essentiels », a-t-il affirmé. Chaque fois qu'une entreprise d'informatique quantique annonce les performances de son dernier appareil, la question se pose systématiquement de savoir comment (ou si) elle est réellement certaine que l'intrication entre les qubits contribue au calcul. Un dissipateur thermique pourrait servir de détecteur de tels phénomènes quantiques, uniquement grâce à sa variation d'énergie. Pour mettre en œuvre cette idée, on pourrait désigner un qubit mémoire dont l'état révèle celui des autres qubits, puis coupler ce qubit mémoire à un ensemble de particules qui serviront de dissipateur, et dont l'énergie pourrait être mesurée. (Vedral a toutefois précisé qu'il est impératif de maîtriser parfaitement le système afin d'éviter toute contamination des mesures par d'autres sources de flux thermique. De plus, cette méthode ne détectera pas tous les états intriqués.)
De Oliveira pense qu'un système existe déjà pour tester leur idée expérimentalement. Lui et ses collègues discutent de cet objectif avec l'équipe de recherche de Roberto Serra à l'Université fédérale d'ABC à São Paulo, au Brésil. En 2016, Serra et ses collègues ont utilisé les orientations magnétiques, ou spins, des atomes de carbone et d'hydrogène dans les molécules de chloroforme comme bits quantiques entre lesquels ils ont pu transférer de la chaleur.
Selon de Oliveira, ce dispositif devrait permettre d'exploiter un comportement quantique – en l'occurrence la cohérence, c'est-à-dire l'évolution en phase des propriétés de deux spins ou plus – afin de modifier le flux de chaleur entre les atomes. La cohérence des qubits étant essentielle à l'informatique quantique, sa vérification par la détection d'échanges thermiques anormaux pourrait s'avérer précieuse.
L'enjeu pourrait être encore plus important. Plusieurs équipes de recherche s'efforcent de concevoir des expériences pour déterminer si la gravité est une force quantique, à l'instar des trois autres forces fondamentales. Certaines de ces recherches consistent à détecter un enchevêtrement quantique entre deux objets, induit uniquement par leur attraction gravitationnelle mutuelle. Les chercheurs pourraient sonder cet enchevêtrement gravitationnel en effectuant de simples mesures thermodynamiques, vérifiant ainsi (ou non) si la gravité est effectivement quantifiée.
Pour étudier l'une des questions les plus profondes de la physique, Vedral a déclaré : « Ne serait-il pas formidable de pouvoir faire quelque chose d'aussi simple et macroscopique que cela ? »
Article original reproduit avec l'aimable autorisation de Quanta Magazine , une publication éditorialement indépendante de la Fondation Simons dont la mission est d'améliorer la compréhension publique des sciences en couvrant les développements et les tendances de la recherche en mathématiques et en sciences physiques et de la vie.
wired





