La santé mentale dans les contextes à forte demande
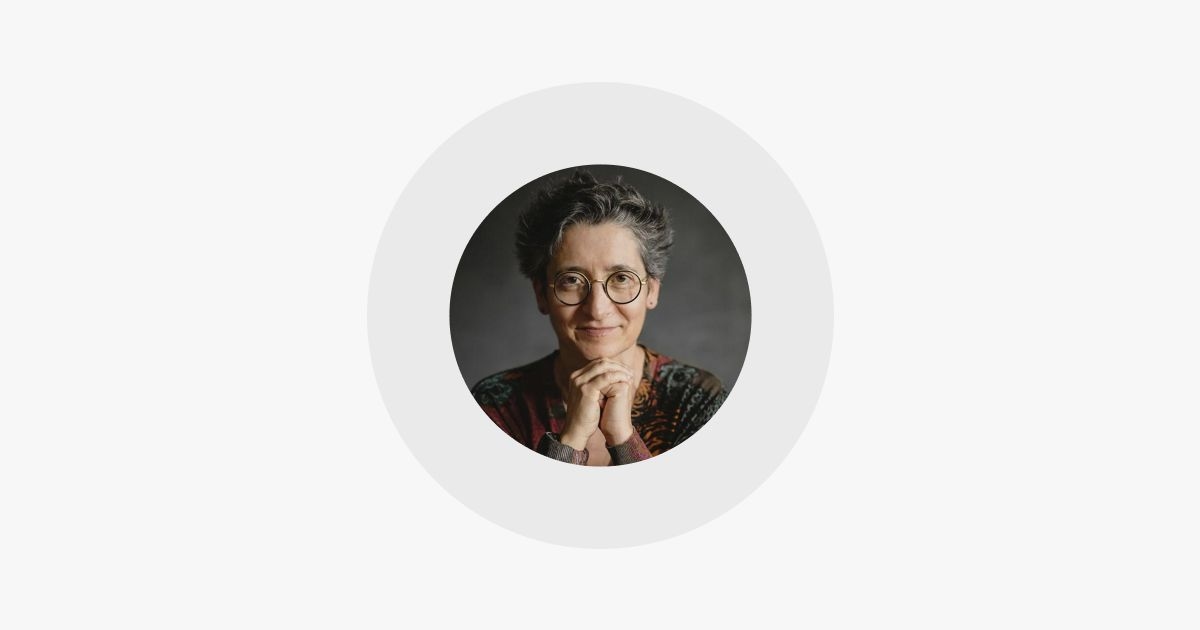
« Pensez que c'est de la chance et que vous ne pouvez pas abandonner » (Carolina Deslandes dans Fatigue ).
Cette phrase apparemment simple est un instantané d’une réalité profonde, bien que souvent obscure : ceux qui poursuivent passionnément leur profession – athlètes, artistes, dirigeants, entrepreneurs – sont souvent ceux qui se sentent le moins capables de dire à voix haute qu’ils sont fatigués ou qu’ils ont besoin d’aide.
Nous vivons dans une société qui idolâtre la performance. Produire plus, montrer plus, accomplir plus : nous aspirons tous (ou la « société » nous y pousse…) à être les protagonistes d'un scénario où nous sommes la figure centrale d'une vie personnelle et professionnelle inébranlable. Une tentative presque enfantine de vivre concrètement ce que signifie vivre dans un contexte de haute performance, mais nous possédons rarement les ressources qu'exige une véritable haute performance. Parmi elles, la vérité sans équivoque du rôle essentiel du repos et de la récupération pour une vie (et une carrière) réussies.
Au lieu de cela, nous laissons le repos aux (très) jeunes ou aux « vieux », car pour tous les autres, le mot « fatigue » est un sujet tabou dont on ne parle pas. On le confond avec la paresse, le manque de motivation ou la faiblesse. Dire « Je suis fatigué » ne correspond pas au récit de la réussite. Or, la fatigue – physique, émotionnelle, ou les deux – peut être le premier signe d'un processus plus dangereux : l'épuisement professionnel.
Un jour, un ami m'a dit en plaisantant : « Un homme, après sa mort, peut encore ramper cinquante mètres. » Nous avons ri. Mais au-delà de la plaisanterie, nous avons observé la culture qui (malheureusement) nous entoure : la validation sociale de l'épuisement comme preuve de valeur. Prendre soin de soi, s'arrêter, se régénérer ? Cela semble faible. Cela semble mal.
Et pourtant, l'épuisement professionnel n'est que l'autre face de la résilience. Une résilience poussée à l'extrême, au point où la capacité d'endurer devient une incapacité à vivre.
La stigmatisation du privilègeLorsqu'on parle d'épuisement professionnel, l'imaginaire collectif nous transporte presque toujours dans le monde de l'entreprise : horaires interminables, patrons exigeants, environnements toxiques. Mais on évoque rarement l'épuisement professionnel chez les personnes dites « de haut niveau » – celles qui s'épanouissent sur scène, dans les grandes enceintes sportives ou dans les salles de décision. Dans ces cas, la pression ne vient pas seulement d'en haut. Elle vient de l'intérieur.
Cette pression auto-imposée, assaisonnée de l’enthousiasme de ceux qui vivent une passion (en l’occurrence, le métier auquel ils se consacrent), se transforme en une locomotive sans freins, trop souvent au bord d’un profond déraillement.
La stigmatisation du privilège – « Si j'ai la chance de faire ce que j'aime et que, en plus, je réussis, comment puis-je oser me plaindre ? » – est un mythe profondément dévastateur. Il empêche les artistes, les athlètes et les dirigeants de reconnaître leurs souffrances. Il les contraint au silence. Et dans le silence, les symptômes s'amplifient.
Simone Biles, peut-être la plus grande gymnaste de tous les temps, a déclaré aux Jeux olympiques de Tokyo : « Je dois protéger ma santé mentale et ne pas mettre en danger ma santé et mon bien-être. » Naomi Osaka, l'une des meilleures joueuses de tennis au monde, a avoué en 2021 ne pas avoir supporté la pression médiatique et s'être retirée du circuit. Plus près de nous, plusieurs musiciens portugais, de Carolina Deslandes à Diogo Piçarra, ont déjà exprimé publiquement leur extrême fatigue et leur besoin d'arrêter. Heureusement, juste à temps.
Les signes silencieuxLe corps et l'esprit nous avertissent avant de s'effondrer. Mais les signes sont subtils : fatigue persistante, insomnie, perte de plaisir dans des activités auparavant gratifiantes, irritabilité, vide émotionnel. Des symptômes qui se normalisent – « ce n'est qu'une phase » – jusqu'à devenir chroniques et nous plonger dans une profonde anesthésie.
Tout comme dans le sport, où une micro-blessure ignorée peut mettre fin à une carrière, en santé mentale, de petits signes, lorsqu’ils sont ignorés, ont tendance à se transformer en pannes plus importantes.
Au Portugal, près de 23 % de la population souffre d'un trouble mental, l'anxiété étant le plus répandu (OCDE, 2023). Chez les jeunes, les chiffres sont encore plus alarmants : environ 31 % déclarent souffrir de symptômes dépressifs, et 20 % des enfants et adolescents vivent déjà avec un trouble mental diagnostiqué. Ces données ne sont pas des abstractions statistiques ; elles concernent des écoles avec des enseignants qui s'épuisent au quotidien dans une fatigue incessante ; des élèves qui n'arrivent pas à apprendre ; des familles épuisées ; des équipes qui se désintègrent de l'intérieur ; des dirigeants incapables de diriger et qui, trop souvent, sont eux-mêmes vecteurs de l'épuisement émotionnel des autres.
Le paradoxe portugaisLe cas portugais est emblématique : nous sommes parmi les pays européens qui consomment le plus de psychotropes et, simultanément, affichent l’un des taux de connaissances en santé mentale les plus faibles. Autrement dit, nous essayons de faire taire les symptômes, mais nous ne parvenons pas à « former » à la prévention. C’est comme prendre des analgésiques tous les jours sans jamais traiter l’inflammation sous-jacente.
Le problème n'est pas seulement structurel, il est aussi culturel. Nous en sommes venus à croire que la santé mentale est synonyme de maladie et non partie intégrante de la santé. Nous continuons à valoriser les discours sur la nécessité de surmonter les difficultés tout en dévalorisant les pratiques de rétablissement cohérentes.
Nous continuons, avec une grande ignorance, à ne pas reconnaître que la résilience n'est pas un talent inné, mais un « muscle » : elle nécessite entraînement, repos et récupération. Et c'est la responsabilité de chacun de nous.
Entraînez votre esprit comme vous entraînez votre corpsPersonne n'envisagerait de courir un marathon sans préparation physique et psychologique. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent pouvoir diriger des entreprises, créer des œuvres ou concourir au plus haut niveau sans développer les compétences psycho-émotionnelles nécessaires à la performance (ou à la carrière) qu'ils convoitent.
Mais la vérité est de plus en plus incontestable : vivre dans des contextes très exigeants exige de construire une architecture psychologique robuste – une structure interne composée de conscience de soi, de gestion de l’énergie, de tolérance à la frustration et de capacité de régénération. C’est cette architecture qui assure une performance à long terme sans compromettre la santé mentale et les relations enrichissantes que nous entretenons avec nos proches, et qui empêche la passion de devenir un fardeau.
En réalité, le langage doit aussi faire partie du changement. Parler du burn-out comme d'une surcharge sans récupération, ou de la résilience comme d'un « muscle », permet non seulement de transformer des concepts complexes en images claires, mais aussi de lever le poids de la stigmatisation, démontrant ainsi que développer des compétences psycho-émotionnelles n'est pas un luxe, mais une nécessité et une responsabilité individuelle.
La science le confirme également : de nombreux programmes d'entraînement psychologique ont démontré une amélioration des indicateurs de santé mentale et de bien-être, une réduction des niveaux d'anxiété et une amélioration des performances sous pression (par exemple, Fletcher et Sarkar, 2016). Et cela ne concerne pas uniquement les athlètes olympiques : ces stratégies s'appliquent aux étudiants, aux professionnels de la santé, aux cadres et à toute personne vivant dans des environnements exigeants.
Il y a juste un « petit problème » : l'entraînement, à proprement parler, et de quelque nature qu'il soit, ne vient pas d'une pilule magique... il vient de la volonté et, souvent, de la détermination qui surgit en l'absence de celle-ci, de faire des choix différents, d'accepter l'inconfort initial et de croire au vieil adage selon lequel « au début, cela semble étrange (de s'entraîner), mais ensuite cela s'enracine ».
Mental est une rubrique d'Observador exclusivement consacrée aux sujets liés à la santé mentale. Fruit d'un partenariat avec l'Hôpital da Luz et Johnson & Johnson Innovative Medicine, elle bénéficie du soutien de la Faculté de psychiatrie de l'Ordre des médecins portugais et de l'Association portugaise des psychologues. Son contenu éditorial est totalement indépendant.
Un partenariat avec :


Avec la collaboration de :
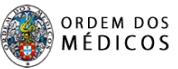

observador




