Enfants intoxiqués: la banalisation du cannabis inquiète les professionnels de santé

Comme RMC vous le révélait fin avril, le nombre d'enfants intoxiqués à la cocaïne a doublé en trois ans. Ils étaient moins d'une vingtaine en 2020, et sont plus d'une quarantaine en 2023. Derrière ces chiffres, il y a des drames, comme cet enfant mort il y a près d'un mois en Bretagne, d'une intoxication à la cocaïne.
Mais plus loin que cette libéralisation de la cocaïne, qui conduit à recrudescence d'empoisonnements, les professionnels de santé s'inquiètent aussi de la banalisation de la consommation de cannabis auprès des enfants.
Lorsque l'un des parents est toxicomane, c'est rare que chez les enfants, on ne retrouve que de la cocaïne, assure la cheffe service des urgences pédiatriques au CHU de Toulouse Dr Isabelle Claudet.
Les intoxications au cannabis, toujours à un niveau très haut depuis une dizaine d'années alerte-t-elle. En proportion, le cannabis c'est dix fois plus que la cocaïne estime-t-elle. Ça concerne 400 à 600 enfants par an dans les services pédiatriques "avec une part importante en réanimation et notamment les plus jeunes, âgés de moins de deux ans".
Elle en voit passer toutes les semaines dans le sien. C'est d'autant plus préoccupant que "l'augmentation des venues aux urgences pour intoxication au cannabis, dit-elle, est directement en lien avec l'augmentation de concentration des produits actifs dans la résine de cannabis".
Les enfants arrivent à l'hôpital avec des problèmes neurologiques importants, parfois même dans le coma. Isabelle Claudet entend souvent les mêmes excuses de la part des parents :
"On a régulièrement des allégations de boulettes de shit retrouvées soit au parc, soit sur le balcon, soit dans l'entrée de l'immeuble."
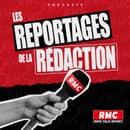
La professeure observe une banalisation de la consommation aux côtés d'enfants :
"C'est comme si c'était quelque chose qui faisait partie de la maison, au même titre que la bouteille de vin rouge ou la cigarette."
Dans les centres antipoisons, le phénomène est moins marqué. Pour la région PACA-Corse par exemple, il y a moins de vingt appels par an désormais dit le professeur Nicolas Simon. Ce qui ne signifie pas que le phénomène est en baisse.
"Quand quelque chose devient régulier, les urgentistes appellent moins parce qu'ils savent comment le gérer." Si tout le monde peut appeler les centres antipoisons explique Nicolas Simon, les médecins d'urgence et les réanimateurs se tournent aussi vers eux en cas de doute. Les données sur la cocaïne feront l'objet d'un article scientifique. Il est en cours de publication.
RMC





